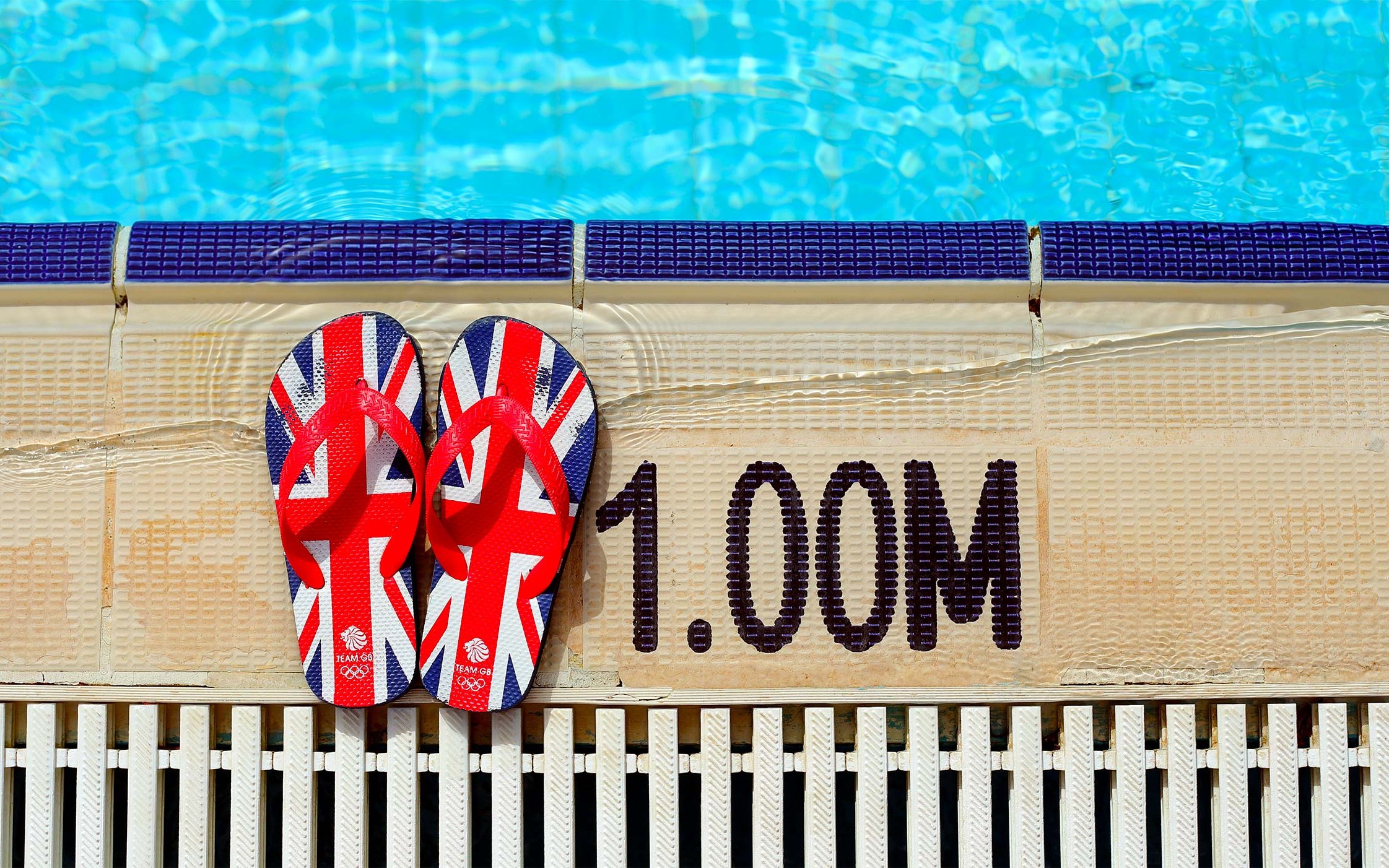Quand les historiens parlent d’Union latine, ils se réfèrent généralement à une initiative prise en 1865 par quatre pays (France, Belgique, Suisse et Italie) en vue d’instituer une organisation monétaire commune, fondée, à l’origine, sur le régime du bi-métallisme or et argent. Elle compta jusqu’à 32 Etats membres, mais ne survécut pas à l’instabilité des marchés monétaires et des marchés des métaux au lendemain de la première guerre mondiale. Elle fut dissoute en 1927.
Mais il existe (ou plutôt il existait) une autre Union latine (UL), organisation internationale elle aussi, créée en 1954 par la Convention de Madrid avec pour objectif d’œuvrer au renforcement des relations entre les cultures de langues romanes. En quelque sorte, une Unesco des pays d’expression latine avec 6 langues officielles : le catalan, l’espagnol, le français, l’italien, le portugais et le roumain. En 2012, l’UL comprenait 35 Etats membres : la plupart des pays d’Amérique centrale et du Sud et, pour la Caraïbe, Cuba, Haïti et la République Dominicaine ; les Etats lusophones d’Afrique ; la Côte d’Ivoire et le Sénégal ; les pays européens de langues latines (dont la Moldavie, mais à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de la Suisse), ainsi que deux pays d’Asie : les Philippines et Timor Oriental.
L’UL disposait d’un siège et d’un secrétariat permanent, situé à Paris et animé par l’ancien ambassadeur espagnol José Luis Dicenta. Ses effectifs avaient compté jusqu’à 50 personnes en 2009, avant de se réduire à 17 en 2012, au sein de 3 directions : Culture et communication ; Promotion et enseignement des langues ; et Terminologie et industries linguistiques. Malgré cette cure d’amaigrissement, l’UL avait maintenu un niveau d’activité très honorable : colloques, participation à des festivals thématiques, expositions, formations à l’intercompréhension des langues latines, publication de glossaires multilingues, banques de terminologie, etc.
C’est tout ce patrimoine qui a été enterré lorsque, le 26 janvier dernier, le congrès extraordinaire de l’UL, tenu en présence des représentants de 26 de ses Etats membres a décidé de fermer son siège à la fin du mois de juillet et de licencier tous ses personnels. Comment en est-on arrivé là ?
L’Union latine a certes une longue expérience de la précarité. Formellement créée en 1954, elle était restée sans budget, sans siège ni programme jusqu’à ce qu’une personnalité hors du commun, Philippe Rossillon, la relance en 1983. Haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères, Rossillon (décédé en 1997) était davantage un homme d’action qu’un diplomate compassé. Ses pairs et sa hiérarchie avaient été trop heureux d’éloigner du Quai d’Orsay ce personnage flamboyant en lui laissant carte blanche pour entreprendre ce qu’ils croyaient être une tâche donquichottesque : donner un contenu à une coquille vide. Grâce à sa richissime épouse, le nouveau secrétaire général – homme frugal par ailleurs - disposait des moyens financiers lui permettant de parcourir le monde pour convaincre les gouvernements de redonner vie à l’Union latine. Et il y parvint largement. Dès décembre 1984, était organisée à Paris une exposition intitulée « A la découverte du monde latin » [1].
Après lui, les secrétaires généraux successifs durent lutter pied à pied pour que les Etats membres honorent leur signature en payant leurs cotisations. Les sommes en question étaient pourtant modiques puisque, ces dernières années, le budget annuel de fonctionnement était seulement de 1,7 million d’euros. A peine le bonus d’un trader de deuxième catégorie à la City de Londres ou à Wall Street… Le montant des cotisations 2012 s’échelonnait de 500 000 euros pour l’Italie à quelque 5 000 euros pour Timor Oriental. Même en période de crise financière, il ne s’agissait donc pas de sommes impossibles à réunir. C’est ce que déclara fort justement le secrétaire général, M. Dicenta, lors du congrès extraordinaire de l’UL de janvier dernier : « Le coût de fonctionnement d’un organisme aux caractéristiques actuelles du nôtre ne saurait en aucune circonstance être la raison justifiant sa disparition ».
Alors quelles raisons ? Sans aucun doute certains gouvernements en quête frénétique d’économies budgétaires, si minimes qu’elles soient, ne pouvaient qu’être tentés par une diminution ou une suppression de leur contribution. Mais ils n’auraient pas sabordé un tel outil s’ils avaient véritablement adhéré à ses objectifs. Il est significatif que l’offensive visant à la dissolution du secrétariat général ait été initialement lancée par l’Italie de Silvio Berlusconi, poursuivie par celle de Mario Monti et appuyée par l’Espagne de Mariano Rajoy et la France de Nicolas Sarkozy, c’est-à-dire par trois gouvernements particulièrement « atlantistes ». Ils ne pouvaient qu’être en désaccord avec la définition de l’Union latine qu’avait formulée Philippe Rossillon en son temps : « Elle ne propose pas des échanges culturels avec le Japon ou les Etats-Unis, cibles de toutes les aspirations à la « reconnaissance », mais des échanges culturels entre Etats aux budgets modestes et aux économies incertaines, et elle va à contre-courant de la tendance universelle à considérer toute langue étrangère autre que l’anglais comme un luxe inutile ».
La résolution du congrès extraordinaire conduisant à « l’interruption immédiate des activités entreprises par le secrétariat et l’utilisation de l’ensemble des ressources disponibles à la dissolution de ce dernier, dans sa forme actuelle » a été votée par 12 voix pour, 7 voix contre et 7 abstentions. Sur les 7 votes opposés à la dissolution du secrétariat, 6 émanent d’Amérique latine (Cuba, Equateur, Guatemala, Nicaragua, Uruguay et Venezuela), le septième étant celui de la Roumanie.
Plusieurs participants ont fort bien analysé la signification politique du scrutin. Ainsi la délégation cubaine a constaté que ce sont les pays « pauvres » qui souhaitaient sauver l’Union latine face aux pays riches. Quant à la délégation du Venezuela, elle a annoncé que son pays fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les idéaux de la latinité puissent être abrités au sein de la Communauté des Etats d’Amérique latine et de la Caraïbe (CELAC) créée en décembre 2011 à Caracas [2]. On notera que 4 des 6 Etats latino-américains récalcitrants (Cuba, Equateur, Nicaragua et Venezuela) sont membres de l’Alliance bolivarienne des peuples de notre Amérique (ALBA).
La symbolique est importante : la CELAC, organisation panaméricaine qui s’est affranchie de la tutelle et même de la présence des Etats-Unis reprendrait le flambeau de la latinité abandonné par les métropoles linguistiques européennes résignées au « tout-anglo-américain ».
 Lecture .
Lecture .