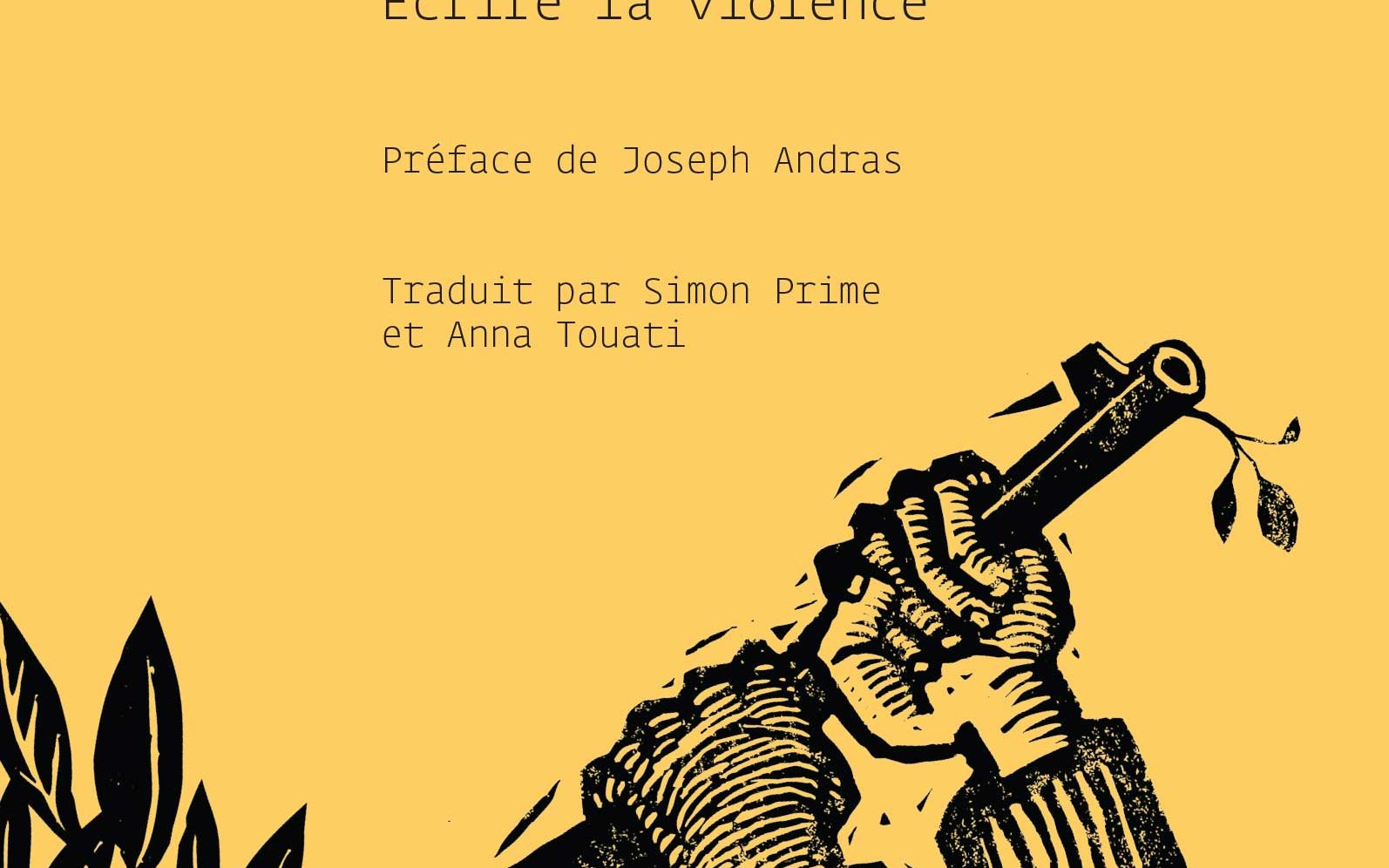Depuis le milieu des années 1990, les tentatives de construction d’un mouvement social à l’échelle européenne se sont multipliées : Etats généraux du mouvement social européen proposés par Pierre Bourdieu (1999), Marches européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions (1997), Euromanifestations à l’initiative de la Confédération européenne des syndicats (CES) [1], Forum social européen (FSE), etc. Autant d’initiatives, d’événements et de processus qui, tous à leur façon, ont cherché, depuis une quinzaine d’années, à impulser une dynamique de convergence des résistances et des luttes sociales au niveau continental.
Plus récemment, ce sont des temps politiques nationaux qui ont su imprimer des dynamiques européennes aux mouvements sociaux et sont parvenus à mobiliser les opinions comme en 2003 lors l’invasion de l’Irak (Italie, Espagne, Royaume-Uni) ou en 2005 lors de la bataille contre le projet de Traité constitutionnel européen (TCE) en France et aux Pays-Bas. De tels succès peuvent-ils être renouvelés grâce aux mobilisations en cours dans certains pays contre les plans d’austérité et permettre de contrer les réformes rétrogrades de gouvernements ? Il est trop tôt pour le savoir. En France, des conditions singulières permettent actuellement au mouvement social d’imposer au gouvernement un rapport de forces inédit depuis des années [2].
Cependant, force est de constater qu’il n’a pas été possible, jusqu’à présent, de construire à l’échelle européenne des mobilisations sociales suffisamment fortes pour impulser un rapport de forces capable de remettre en cause les politiques des gouvernements (sociaux-libéraux, de droite ou de centre-droit), celles de l’Union européenne, et de mettre en danger les forces du capitalisme financier. Et ce, notamment au cours du dernier cycle de luttes sociales marqué par l’émergence de l’altermondialisme et des FSE dans les années 2000.
Ce dernier, en particulier, n’a pas réussi à devenir le point d’appui espéré. Processus en crise, il a même perdu une partie importante des composantes qui s’y engageaient (voir encadré 1). De notre point de vue, cette évolution s’explique par des raisons structurelles – en partie indépendantes des acteurs - qu’il convient d’identifier. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous tenterons d’en pointer quelques unes. Puis, à partir de ce constat, nous essaierons de tracer quelques perspectives stratégiques relatives aux préoccupations et aux opportunités des mouvements sociaux dans la phase actuelle. Le risque d’un tel travail est de se heurter à la formulation de conclusions immédiatement peu optimistes. Sauf à penser avec Antonio Gramsci qu’il faut toujours chercher à « avoir une parfaite conscience de ses propres limites, surtout si on veut les élargir ».
1-. L’approfondissement de la crise du capitalisme ne bénéficie pas aux forces sociales et politiques progressistes
Au-delà des débats qui traversent les mouvements sociaux et la gauche sur la nature du projet européen qu’il s’agirait de développer pour remplacer l’actuel [3], beaucoup s’interrogent sur la stratégie à suivre, alors que la crise du capitalisme et la délégitimation de l’idéologie néolibérale s’approfondissent… sans que cette crise ni cette délégitimation n’aboutissent pour autant au renforcement des forces progressistes, politiques et sociales en Europe.
Les tensions dans nos sociétés s’exacerbent, l’instabilité politique et sociale grandit, les élites financières, économiques et politiques dominantes infligent aux peuples le paiement (au prix fort) d’une crise économique qu’elles ont elles-mêmes déclenchée. C’est la fonction des plans d’austérité qui saignent les populations (en particulier les salariés) et conduisent l’Europe dans une spirale récessionniste grave.
Pourtant, une dynamique de convergence des luttes sociales au niveau européen peine à voir le jour. Au niveau national, celles-ci revêtent des formes et des niveaux d’intensité très disparates selon les pays. Partout où elles s’organisent, et malgré des capacités de mobilisation significatives dans quelques pays (voir encadré 2), elles échouent pour le moment à faire reculer les gouvernements et leurs politiques de classe en faveur des oligarchies [4].
Les mouvements sociaux doivent ainsi gérer une situation paradoxale : la crise s’approfondit, les mécontentements se multiplient, les gardiens de l’ordre dominant se radicalisent mais l’addition de ces facteurs ne débouche pas sur une dynamique « gagnante » pour ceux qui défendent l’intérêt général des peuples.
Dans le même temps, rien n’indique, sur le plan politique, une issue progressiste à cette crise. Ainsi, il est préoccupant de constater que l’exaspération des populations se traduit, en premier lieu, par l’émergence d’une nouvelle droite-extrême dont la rhétorique et les thématiques se renouvellent, notamment sur le terrain de la question sociale et du travail. De l’Autriche à la Belgique, de la Suède à la Hongrie, en passant par les Pays-Bas, de la Norvège à l’Italie ou au Danemark, la décennie 2000 a donné naissance à de nouveaux partis xénophobes qui manient un discours de protection des travailleurs face à la mondialisation, aux politiques du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne sur un mode réactionnaire, anti-immigrés, nationaliste et régionaliste. Leur base sociale apparaît constituée d’ouvriers, d’employés, de petits commerçants et d’artisans. Certaines de ces forces font partie (ou soutiennent) des coalitions gouvernementales (Danemark, Italie, Pays-Bas, Lettonie) et/ou sont présentes dans les parlements de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, de Slovénie, d’Autriche, de Hongrie, de Slovaquie, de Grèce, de Bulgarie, du Danemark, de Suède, de Lituanie et de la Lettonie. Globalement, la liste des pays où ces partis progressent s’allonge : Suède, Danemark, Norvège, Autriche, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Lituanie, Italie, France, Bulgarie et Hongrie. Cette tendance s’inscrit dans une dynamique mondiale, y compris dans les pays du Sud [5].
Il est enfin une autre réalité qui fait frémir. C’est un gouvernement d’ultra-droite en Hongrie – « libéral-national » selon le premier ministre Viktor Orban - qui dit « Non » aux potions amères du FMI et aux recommandations de l’UE ( pour toutefois mener son propre plan d’austérité…)…lorsque, dans le même temps, le président de l’Internationale socialiste et premier ministre grec, George Papandreou, ou Monsieur José Luis Rodriguez Zapatero, président socialiste du gouvernement de l’Espagne [6] se révèlent les meilleurs élèves du FMI que dirige un autre « socialiste », Dominique Strauss Kahn.
2. - Conditions politiques et sociologiques des luttes
Affaiblissement du mouvement ouvrier, sentiment de déclassement vécu par des franges significatives des classes moyennes, conversion de la social-démocratie au néolibéralisme, déficit objectif de groupes sociaux et d’organisations portant les revendications alternatives du mouvement social : autant de facteurs qui profitent, pour le moment, essentiellement aux forces réactionnaires…
Pourtant, les mouvements sociaux et l’altermondialisme fourmillent de propositions politiques pour contrer le néolibéralisme et offrir, en particulier, de nouveaux paradigmes face au capitalisme productiviste et consumériste. Mais nous devons admettre que, dans la période actuelle, le problème est moins une question de « propositions » ou de « projets » que de groupes sociaux existants et d’organisations mobilisées pour les porter.
Ce qu’il convient d’analyser, ce sont les conditions objectives dans lesquelles se mènent les luttes de ces mouvements. Au sujet de la lutte des classes dans le cadre de la construction nationale, Louis Althusser remarquait jadis que : « La nation ne peut se constituer par décret. Elle est l’enjeu d’une lutte de classes, mais le résultat de cette lutte, qui a pour objectif non la conquête d’une forme qui existe déjà, mais la réalité d’une forme qui n’existe pas encore, dépend donc de la disposition des éléments existants » [7].
Du point de vue stratégique, cette réflexion conserve toute sa pertinence dans le cadre du combat pour changer l’Europe. « Disposition des éléments existants » : voici une des clés du problème auquel sont confrontés les mouvements sociaux qui tentent de construire des convergences au niveau continental.
Sur le plan des conditions politiques et idéologiques, l’effondrement du communisme d’Etat continue de peser durablement sur les organisations politiques et sociales issues du mouvement ouvrier des 19ème et 20ème siècles. Pour sa part, la social-démocratie, largement convertie au néolibéralisme, apparaît comme enkystée dans la mise en place de politiques d’accompagnement du capitalisme financier. Elle est aujourd’hui confrontée à l’échec de la substitution de son idéal socialiste par la promesse d’une « Europe sociale » jamais réalisée. Des pans significatifs de son électorat se dirigent actuellement, et tendanciellement, vers l’ultra-droite et l’extrême droite.
Sur le plan socio-économique, la période qui a suivi la fin de l’Union soviétique et l’érosion constante des partis communistes et du mouvement ouvrier en général en Europe, a entraîné une transformation majeure du régime économique : les trois dernières décennies ont, en effet, marqué le passage du capitalisme industriel au capitalisme financier. L’émergence de ce dernier a modifié la structure des activités, du travail et des classes sociales, notamment au sein des catégories populaires. Elle s’est traduite par le déclin relatif et progressif de la classe ouvrière industrielle et manuelle et, dans le même temps, elle a produit un nouveau prolétariat issu du développement de l’économie des services. Confrontés à l’intermittence dans le travail, au chômage et à la précarité, les groupes sociaux de ce secteur (principalement les jeunes, les femmes et les immigrés qui en constituent les contingents de travailleurs précaires et pauvres) sont par définition moins socialisés dans des espaces de luttes durables, organisés et conscientisés.
Comparant notre époque à celle qui vit la formation de la classe ouvrière, l’historien britannique Eric Hobsbawm fait une analyse lucide : « le déclin de la classe ouvrière manuelle dans l’industrie n’est pas terminé. Il y a, et il y aura toujours, des masses de gens effectuant un travail manuel (…). Mais ils n’ont pas, même en théorie, de potentiel politique, car il leur manque le potentiel d’organisation qu’avait l’ancienne classe ouvrière. De plus, sont venus s’ajouter trois développements négatifs. Le premier est le développement de la xénophobie – ce qui, au sein de la classe ouvrière constitue, comme August Bebel l’avait pointé, « le socialisme des imbéciles » : je sauve mon travail contre ceux qui me concurrencent. Plus le mouvement ouvrier est faible, plus la xénophobie est forte. Le second est le fait que beaucoup de travailleurs manuels (…) n’ont pas d’emploi permanent. Ce dernier est devenu temporaire. Cela concerne les étudiants, les immigrés, etc. Ainsi, il n’est pas facile de développer un potentiel d’organisation. » Et d’ajouter, au sujet des classes moyennes éduquées et intellectuelles : « Selon moi, le troisième et plus important développement est la division croissante qui se produit [du fait] des systèmes éducatifs [entre] les éduqués – classes moyennes et intellectuels qui sont tendanciellement plus à gauche que d’autres catégories - et la masse des pauvres et des non éduqués. Ces deux groupes sont essentiels pour construire l’unité d’un mouvement, mais ils sont plus difficiles à unir aujourd’hui qu’auparavant. » [8]
Aujourd’hui, seule une partie des classes populaires - le salariat stable, que l’on retrouve encore dans les grandes filières industrielles et la fonction publique - , ainsi qu’une fraction de la classe moyenne intellectuelle progressiste - mais qui vit en dehors des réalités socio-culturelles des classes populaires -, sont en mesure, sur les plans économique et culturel, de s’engager dans des dynamiques de luttes.
Si les dominations du capital affectent des fractions toujours plus importantes des populations, ce qui devrait favoriser potentiellement la constitution de nouvelles masses rejetant le modèle économique et social, l’absence de perspectives historiques de la classe ouvrière et, parallèlement, la formation d’un nouveau prolétariat précaire, freinent considérablement la formation d’un nouveau sujet politico-social mobilisé. Elle s’avère d’autant plus difficile dans un espace économique et financier élargi - l’Union européenne - où la lutte des classes ne pourra s’appuyer sur l’instrument démocratique pour la stimuler, comme ce fut le cas au 20ème siècle dans les cadres nationaux. En effet, c’est peu de le dire, l’Union européenne organise de manière consubstantielle le recul des droits démocratiques des peuples et des citoyens. Elle institue une « démocratie limitée » - à l’échelle continentale et nationale - dans laquelle l’économie, la finance, la politique monétaire sont des domaines mis hors de portée de la souveraineté populaire [9]. Il est illusoire d’envisager sa démocratisation à échéance prévisible et compatible avec la nature des défis à relever pour inverser le cours des choses.
Mais, dans le même temps, la situation française montre que les mouvements sociaux subissent une double peine. Dans les conditions actuelles, le cadre de la démocratie nationale ne garantit plus non plus leur prise en compte et leur succès. Jamais un gouvernement essuyant autant de journées de mobilisations massives (entre 3 et 4 millions de personnes dans les rues au cours de sept journées d’actions) n’a opposé, dans le même temps, autant d’intransigeance et de surdité à l’expression populaire et la contestation sociale organisées. La légalité parlementaire est désormais ouvertement agitée contre la démocratie sociale. Dans le cadre de la démocratie nationale, les institutions aux mains des maquignons sont utilisées contre l’intérêt général.
Des signaux préoccupants avaient déjà été identifiés ces dernières années lors de la gestion par différents gouvernements européens du rejet du TCE, puis du traité de Lisbonne, par les peuples français, néerlandais (2005) et irlandais (2008). Le vote de chacun d’entre eux a été soigneusement contourné par les gouvernements et les parlements nationaux.
A l’échelle européenne, les forces sociales apparaissent affaiblies. Si nombre de pays européens ont connu de puissants mouvements ouvriers par le passé, aujourd’hui seule une poignée de pays offrent des mouvements sociaux résistants au capitalisme financier. Mais leur cadre d’intervention reste essentiellement défensif. La dynamique des mouvements sociaux en Europe correspond à cette carte politico-historique.
Seuls quelques pays (Allemagne, Belgique, France, Italie, puis, dans une moindre mesure, l’Espagne et les pays scandinaves) disposent d’un maillage significatif de syndicats, d’ONG, de mouvements sociaux et de partis leur permettant de s’inscrire dans des dynamiques collectives de projection dans l’espace européen. Bien d’autres, en particulier en Europe centrale et orientale ou au Royaume-Uni pour des raisons de traditions historiques et de rapport à l’Europe, contribuent modestement à l’existence d’un mouvement social européen. La faiblesse de ce dernier résulte en premier lieu de celle des mouvements sociaux dans chaque pays pris individuellement.
3.- Forum social européen, mouvement syndical et éléments de stratégie dans la période
Qu’en est-il des acteurs sociaux actuels ? Tout d’abord, ils sont confrontés à un déficit de connaissances des situations nationales dans le cadre du capitalisme européen.
En effet, après six éditions du FSE (2002-2010), il est frappant de constater à quel point les acteurs de ce processus méconnaissent encore la composition des mouvements, les traditions sociales, les agendas politiques, l’état des conflits, les modèles économiques, juridiques et sociaux des pays, les stratégies des oligarchies nationales, etc. Il manque une évaluation réaliste des forces accumulées en dix ans. En dehors d’un cercle formé par quelques pays de la partie occidentale de l’Europe (France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique), l’espace européen reste largement inconnu pour les acteurs qui participent de manière permanente au processus.
Dans le même temps, l’analyse du capitalisme européen reste également à approfondir. Si tous les gouvernements appliquent la même feuille de route économique décidée au niveau de l’UE, les modalités et les temporalités de mise en œuvre sont différentes. Cette dernière se heurte à différentes traditions sociales et juridiques. De plus, dans l’espace d’interdépendances concurrentielles que constitue le marché unique pour les bourgeoisies nationales, subsistent néanmoins des intérêts propres à chacune d’entre elles, notamment depuis la crise de 2008. Le patronat et les banquiers allemands n’ont pas forcément les mêmes intérêts que leurs homologues grecs ou slovènes… Il en résulte des stratégies différentes imposées par les acteurs capitalistes aux différentes sociétés qui composent l’espace européen.
Nous connaissons encore mal, dans ce cadre, les relations entre les acteurs capitalistes [10].
L’ensemble de ces facteurs, et leur combinaison mouvante au gré des évolutions de la crise, impriment le rythme et la nature des mobilisations de résistance. De ce fait, le développement de luttes sur des objectifs communs à l’échelle européenne et leur articulation, nécessaires, sont rendues par nature difficile quand il s’agit, dans le même temps à l’échelle nationale, de défendre les espaces conquis par les luttes des périodes antérieures.
De plus, la crise économique semble ouvrir une nouvelle séquence dans plusieurs pays européens. Une offensive est en cours visant à accroître la flexibilité sur les marchés du travail au nom de la recherche de compétitivité. Alors qu’elle s’inscrit dans la redéfinition des rapports de forces internes au sein des bourgeoisies en Europe, elle génère des alliances entre certains syndicats et des entreprises nationales. Des accords aux contours nouveaux prévoient l’acceptation, par les syndicats, d’une flexibilité accrue dans le travail (qui se traduit par un recul des droits sociaux et syndicaux des salariés, la remise en cause des contrats de travail, etc.) en l’échange d’engagements limités ou illimités dans le temps de non licenciement et de non délocalisation [11] (sans remise en cause des salaires ou, parfois, en prévoyant même leur augmentation comme c’est le cas dans le projet d’accord Fiat). En Italie, un accord national entre tous les syndicats et la Confindustria vient d’être signé au nom de la « relance » du pays.
Comment analyser, pour la construction d’un mouvement social en Europe, le sens et les répercussions de la recrudescence de ce type d’accords signés, notamment depuis quelques mois, dans différentes industries (automobile, télécommunication, etc.) ? Et ce, au moment où nombre de multinationales sont confrontées à la montée des conflits du travail dans les pays du Sud ?
Nous vivons une période paradoxale qui met à jour notre faiblesse structurelle. Nous savons qu’une stratégie misant sur des défenses strictement nationales signerait, à terme, une défaite globale face au capital pour les mouvements sociaux en Europe. Mais la lucidité oblige à mesurer combien la perspective d’un mouvement continental est aujourd’hui lointaine au vu des conditions politiques et sociales objectives et de la configuration générale des forces.
Ajoutons que l’intégration du mouvement syndical au jeu institutionnel européen pèse sur les capacités de résistance des mouvements sociaux. Ainsi, la CES, qui participe au FSE tout en gardant ses distances, se positionne comme acteur d’un « dialogue social européen » tel que le conçoivent les institutions européennes. Même si elle prend parfois des positions plus critiques que par le passé (comme c’est le cas sur la question des plans d’austérité ou des retraites), la CES fait partie du champ du pouvoir européen, au même titre que le patronat réuni au sein du Business Europe et de la Confédération européenne des entreprises publiques (CEEP). L’intégration des structures syndicales nationales - dont certaines sont déjà devenues largement acritiques face au libéralisme - aux institutions influe également sur leur niveau de critique de l’Union européenne et de ses politiques.
De même, tout porte à craindre que le poids des acteurs d’expertise (ONG, associations) dans l’altermondialisme des années 2010 (dont les ressources financières et la tradition de lobbying institutionnel permettent une implication durable dans un travail de réseaux et de campagnes thématiques) conduise progressivement l’action contestataire vers une stratégie d’intégration à la « société civile européenne ».
Enfin, la question de l’articulation entre mouvements sociaux et forces politiques menant un combat commun peine à se résoudre dans le cadre de l’espace européen. En témoignent les fortes réticences qu’une telle perspective suscite au sein de l’Assemblée de préparation du FSE. Pourtant, jamais cette question n’est devenue aussi décisive alors que nous assistons à la destruction progressive de la démocratie dans nos pays et sur notre continent.
Dans ces conditions, quelles sont les questions à l’ordre du jour pour les mouvements sociaux européens, en particulier pour ceux impliqués dans le FSE ?
Dans un premier temps, il nous semble que le travail d’accumulation de savoirs sur les situations nationales doit se poursuivre et se développer. Nous devons mieux connaître le terrain que nous souhaitons mettre en mouvement et considérer que nous sommes, en réalité, au début d’un long processus. Accumulation de forces et utilisation des voies de passages que ne manquera pas d’ouvrir un capitalisme en crise dans les années à venir constituent notre feuille de route.
Dans ce contexte, les mobilisations françaises sont un événement nouveau à prendre en compte. Leur force, quelle que soit l’issue concrète qui adviendra dans le conflit sur la réforme des retraites, pèsera positivement sur d’autres luttes. En France, elles ont permis l’apparition et l’accumulation de nouvelles forces politisées, notamment au sein des jeunes, l’accroissement des solidarités entre secteurs professionnels et la mesure de l’étendue des secteurs de la société brimés par les politiques néolibérales du gouvernement de Nicolas Sarkozy. On peut penser que ce combat trouvera un prolongement et une traduction sur le terrain politique. En Europe, ces mobilisations vont permettre, dans un contexte de reflux, d’accroître la solidarité entre les acteurs sociaux mobilisés à l’échelle continentale. Ce processus est déterminant pour la construction de fronts élargis à l’avenir. A n’en pas douter, acteurs sociaux, syndicaux et politiques en Europe analyseront, dans la période qui s’ouvre, les stratégies possibles à développer en commun. Face au rouleau compresseur de l’Union européenne, les mouvements sociaux pourraient déployer de nouvelles formes d’action plus directement ciblées contre les pouvoirs européens et leur agenda réellement existant (Conseil européen, votes au Parlement européen, décisions de la Commission, etc.).
Ce travail doit accompagner la nécessaire poursuite du FSE, malgré tout. Il constitue en effet le « seul espace public européen supranational où différents acteurs et sujets sociaux, syndicats, associations, et même représentants politiques, continuent de se rencontrer, de dialoguer, de former des réseaux. Il est un instrument de débat et parfois de mobilisation » [12]. Cependant nous devons mesurer que cet espace, s’il peut représenter une référence commune pour les mouvements, ne constituera pas, pour autant, un espace de centralité et de vitalité dans une période caractérisée par une dynamique défensive et où les mouvements sociaux et leurs mobilisations à l’échelle européenne demeurent embryonnaires.
Une question se pose et commence à faire son chemin. Face aux limites actuelles de l’hypothèse « mouvement social européen » pour changer l’Europe, ne devons nous pas tracer une perspective plus directement politique tout en poursuivant le travail à moyen et long terme d’accumulation de forces et de recherche de convergences des mobilisations sociales ? Il s’agirait de s’engager pour qu’un gouvernement, parvenu au pouvoir si les conditions le permettent dans un pays d’Europe, puisse assumer, sur de nouvelles bases coopératives et progressistes, des ruptures partielles et unilatérales avec l’Union européenne. Ces ruptures pourraient tout à fait s’effectuer en restant dans le cadre formel de l’UE. Elles auraient pour conséquence de plonger l’ensemble de l’édifice dans une crise politique et institutionnelle majeure. Un tel engagement signifierait, à n’en pas douter, l’annonce d’un vrai changement.
 Lecture .
Lecture .