Première partie de l’entretien
Guillaume Beaulande (GB) : De nombreux observateurs de la situation économique mondiale semblent avoir quelque difficulté à définir précisément le bloc constitué par les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et les pays dits « émergents » en général. Dans votre dernier ouvrage, vous soulignez cette faille analytique et expliquez que ces pays ne constituent en rien un bloc monolithique. Pourquoi préférez-vous parler de « tout différencié » à leur endroit ?
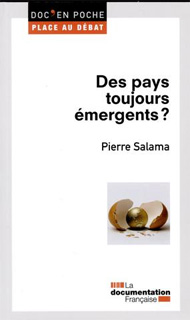
Pierre Salama (PS) : Aujourd’hui, les pays émergents ont peu de choses communes entre eux, sinon, et c’est important, leur niveau d’industrialisation qui n’est pas comparable avec celui des pays dits « en voie de développement » ou des « moins développés » comme le Tchad, etc. C’est un point commun majeur. C’est pourquoi on les caractérise comme étant relativement industrialisés. L’expression « émergents » a été utilisée pour la première fois par la banque d’affaires Goldman Sachs. Il s’agissait alors pour elle d’identifier des marchés financiers, notamment ceux de la Chine et de Hong Kong. Par la suite, compte tenu de la croissance élevée des pays asiatiques, on a commencé à utiliser l’expression pour l’appliquer non plus à des marchés, mais à des pays. Il s’agissait de dire que leurs niveaux de revenu national, déjà assez élevés par rapport aux pays moins avancés, tendaient désormais à converger avec ceux des pays avancés, autrement dit que leurs taux de croissance étaient très élevés.
Actuellement, à l’exception de la Chine et peut-être de l’Inde, on a plutôt tendance, concernant l’Amérique latine par exemple, à observer que s’il y a convergence avec les pays avancés, elle ne se réalise pas sur le niveau de développement mais sur celui des taux de croissance. Aujourd’hui, le Brésil dispose d’un taux de croissance à peu près équivalent à celui de la France, c’est dire si une page se tourne.
Cela étant, au-delà de la tendance sur longue période d’une convergence avec les pays avancés, les différences entre les pays dits « émergents » sont nombreuses. Ils n’ont pas la même histoire. Par exemple, ils ont connu pour la plupart des formes de colonisation très différentes. Par ailleurs, les taux d’investissements sont très variés d’un pays à l’autre, la Chine flirte avec un taux de 50% du PIB alors que le Brésil a un taux inférieur à 20%. Leurs modèles productifs diffèrent également : en Amérique latine par exemple, on assiste à une « reprimarisation » des économies liée à l’approfondissement d’un modèle économique basé sur l’exportation de matières premières à faible valeur ajoutée. Pour sa part, la Chine exporte plutôt des produits manufacturés et l’Inde, des services.
Dans ces conditions, pourquoi néanmoins avancer l’idée d’un « tout » ? Parce qu’on a malgré tout affaire à un bloc qui s’est imposé ces dernières années et qui a participé activement à ce que l’on a appelé le basculement de la division internationale du travail. Cette dernière a posé de nombreux problèmes aux « pays avancés ». Un seul exemple, il y a encore quinze ou vingt ans, les États-Unis, à l’époque des accords du GATT, pouvaient décider de façon unilatérale telle ou telle mesure sans que personne ne puisse contester. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Des blocs se sont constitués qui peuvent remettre en question certaines décisions prises par les pays avancés en matière de protectionnisme par exemple. C’est très important.
Mais dans le même temps, ce bloc est contradictoire en son propre sein. Les relations existantes entre pays émergents sont souvent des relations de sous-impérialisme. Nous sommes donc en présence d’une contradiction principale active entre pays émergents et pays avancés et d’une contradiction secondaire agissant, elle, entre membres du bloc des émergents. C’est pourquoi je préfère cette expression de « tout différencié » pour éviter d’utiliser le concept-valise de « pays émergents » qui ne tient pas compte de leurs spécificités.
GB : Aujourd’hui, lorsqu’on positionne le curseur de la discussion sur les limites des économies dites « émergentes », n’y voit-on pas une conséquence de la crise traversée par les pays dits « émergés » ? Autrement dit, la théorie des vases communicants selon laquelle ce qui nuit aux uns (« le centre ») profite mécaniquement aux autres (« la périphérie) ne serait-elle pas erronée ?
PS : C’est une thèse erronée en effet. C’est la thèse du jeu à somme nulle. Quand il n’y a pas de croissance, si l’un croit, ce serait au détriment de l’autre. Si l’on regarde ce qui s’est passé depuis dix ans, la croissance mondiale est poussée principalement, à hauteur de 70% environ, par celle des pays dits « émergents ». C’est ce qui donne l’illusion d’une croissance moyenne relativement importante. Malheureusement ou heureusement, les choses sont plus compliquées. En effet, par exemple, ces indicateurs ne nous disent rien des inégalités de répartition de cette croissance entre pays et au sein des pays.
GB : Lors du sommet ibéro-américain de novembre 2012 qui se tenait à Cadix, c’est l’Espagne qui réclamait l’aide des investisseurs latino-américains...
PS : Cela démontre une chose très importante. Le basculement de la division internationale du travail est tel qu’il remet en question les outils d’analyses, les concepts que nous avions de « centre » et de « périphérie ». On ne peut plus parler de la « périphérie » comme à l’époque de Rosa Luxemburg ou de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal) dans les années 1950 parce que ces pays jouent un rôle de plus en plus important. Ces pays, comme la Chine, n’exportent plus seulement des produits manufacturés, mais aussi des capitaux. Ceux-ci ne vont pas se placer sur les marchés financiers mais se dirigent vers l’industrie, les infrastructures, etc. Le Portugal, l’Espagne et la Grèce ont aussi demandé l’aide de la Chine parce qu’elle dispose de liquidités dont ne disposent pas les autres pays.
Ces concepts, comme tous les concepts que l’on forge, doivent être historicisés sinon nous risquons de tomber dans le vulgaire structuralisme. Le concept de « périphérie », encore utile voilà quelques années, n’est plus utile, c’est pourquoi je préfère parler de « nouvelles dépendances ». Ce ne sont pas des dépendances classiques comme hier. Ce sont de « nouvelles dépendances » en ce sens que les pays dits « émergents » ont leurs fragilités propres, ils ne sont plus seulement dépendants des pays avancés, mais aussi interdépendants. Le Brésil, par exemple, est à la fois dépendant de la Chine et des États-Unis...
GB : Vous soulignez que l’un des facteurs déterminants dans la redistribution des règles du jeu économique mondialisé a été « l’éclatement de la chaîne de valeur » des années 1990. En quoi cela a-t-il consisté et comment cela s’est-il produit ?
PS : Ce phénomène existe depuis très longtemps mais il n’a jamais atteint une telle ampleur. Cela a commencé avec ce qu’on a appelé les « Dragons asiatiques » à la fin des années 1960 (Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong), relayés ensuite par les « Tigres » (Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam et les Philippines). Certains parlaient de « sous-traitance internationale », moi je préférais parler de « segmentation-délocalisation », c’est-à-dire qu’un segment de la ligne de production était délocalisé pour diminuer les coûts du travail notamment et augmenter leur « compétitivité ».
Dans les années 2000, on a assisté à une généralisation de ce processus. Ce sont tous les segments de la ligne de production qui ont été « éclatés » pour un nombre de produits industriels relativement important. Par exemple, si l’on regarde la balance commerciale des États-Unis dans l’importation des produits Apple (ordinateurs, téléphones...), on se rend compte que les Etats-Unis ont un déficit d’environ deux milliards de dollars, autrement dit, les États-Unis payent cette somme à la Chine, qui ne fait que de l’assemblage. Lorsqu’on regarde de plus près, on constate que dans ces deux milliards, seulement 75 millions sont chinois, 350 millions sont coréens, et à peu près autant sont allemands, etc. La fabrication d’un produit est donc aujourd’hui immédiatement mondiale. C’est un point très important parce que dans sa tentative de faire comme les Coréens, la Chine, qui souhaite faire de « l’intégration » et produire sur place les « inputs », rencontre de nombreuses difficultés. La stratégie des multinationales est différente de celle qui présidait dans les années 1970. La tâche est plus difficile que lorsque la Corée l’a mise en place dans les années 1970...
GB : Il existe selon vous un risque de reformation de cette « chaîne de valeur classique » au sein même du commerce Sud-Sud. On observe en effet une « reprimarisation » des économies d’Amérique latine. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène ?
PS : C’est un point très intéressant parce que le commerce mondial se caractérise ces dernières années par l’essor des « émergents » pour l’essentiel. Mais lorsqu’on pousse l’analyse, on constate qu’hier, ce qui prévalait, c’était le commerce Nord-Nord et Nord-Sud. Aujourd’hui, le commerce Sud-Sud représente 40 % du volume des échanges mondiaux, ce qui n’est pas rien. Ce commerce Sud-Sud a lieu principalement entre pays asiatiques, c’est ce qu’on appelle là-bas l’ « intégration silencieuse ». Par exemple, le premier client de la Chine, paradoxalement, ce ne sont pas les États-Unis mais la Corée du sud. Ce qui suppose un entrelacement des relations plus puissant que jamais. En revanche, en Amérique latine, cet éclatement de la chaîne de valeur est assez faible car il y assez peu d’échanges au sein de la région. Dans les relations Sud-Sud, entre l’Asie et l’Amérique latine, il n’y a pas d’éclatement de la chaîne de valeur. On assiste à un retour de la spécialisation de type 19e siècle impliquant des vulnérabilités très importantes. La « reprimarisation » des économies de l’Amérique latine est préoccupante. Cette région a bien connu une phase d’industrialisation entre 1940 et 1980, mais désormais, on observe le retour d’une spécialisation économique autour des matières premières avec ses principaux clients asiatiques : la Chine et l’Inde.
L’Amérique latine et l’Afrique vont profiter de cette « bonanza », de cette hausse des prix et de la demande chinoise pour obtenir des devises. Cette « bonanza » va à la fois permettre de desserrer la contrainte externe et de financer des politiques sociales via les impôts tirés des exportations comme c’est le cas de l’Argentine par exemple. On revient vers l’ancien système. La fiscalité et les politiques sociales finissent par dépendre de plus en plus de la rente.
Depuis deux ans, les économies du Brésil et de l’Argentine souffrent de la baisse du prix et du volume d’exportation des matières premières. En somme, pour reprendre un vieil adage qu’on employait à propos de General Motors, lorsque la Chine attrape un rhume (ce qui est en train de se passer), l’Amérique latine et les pays africains attrapent une pneumonie. C’est une des erreurs des gouvernements progressistes que de trop compter sur le « papa chinois ». Il faudrait plutôt développer une politique industrielle afin de penser l’avenir. La diminution des inégalités et de la misère sociale est évidemment une bonne chose, mais on ne peut pas penser uniquement en ces termes-là. La preuve en est que la pauvreté aujourd’hui augmente de nouveau au Brésil et en Argentine à cause de cette cécité. La politique est un jeu d’échec, il faut toujours penser au coup d’après, sinon on se fait avoir.
Concrètement, le Brésil est un pays de plus en plus rentier sur le plan agricole, industriel (le soja et le fer), mais aussi financier (il est dépendant des hausses d’intérêts) et n’a un taux d’investissement que de 18% du PIB, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas dépasser 3% de croissance par an s’il continue sur cette voie. Néanmoins, les pays de « gauche » latino-américains ont encore les moyens de changer la donne s’ils ne veulent pas connaître de grandes difficultés dans le futur.
Deuxième partie de l’entretien
Guillaume Beaulande (GB) : Dans votre ouvrage, vous affirmez que les relations économiques et commerciales entre la Chine et l’Amérique latine sont « non durables ». Vous parlez même d’un risque de « syndrome hollandais ».
Pierre Salama (PS) : Oui, dans les années 1960, les Pays-Bas ont connu une augmentation du cours de leur matière première (le gaz) qui se présentait comme une véritable aubaine. Mais ils se sont rendus compte assez rapidement que cela mettait en difficulté leur industrie nationale et leurs autres secteurs productifs. Pourquoi ? A cause de l’afflux massif de devises qui a provoqué une appréciation de leur monnaie telle que les importations étaient bien moins chères. Cela a conduit à une phase de désindustrialisation. Un effet « collatéral » assez grave qu’ont également connu un certain nombre de pays africains. Il s’est passé à peu près la même chose en Amérique latine, sauf en Argentine, du moins jusqu’en 2010. Après la fin du plan de convertibilité tragique (1 peso = 1 dollar) en 2001, la monnaie a « explosé », l’Argentine a choisi de maintenir un taux de change relativement peu apprécié.
En revanche, le Brésil a tout fait pour favoriser l’appréciation de sa monnaie partant du principe que cela permettait de produire moins cher. En effet, ce phénomène décélère la hausse des prix mais rend difficile les exportations, d’autant plus que le niveau de productivité (sauf dans certains secteurs comme l’aviation), tout comme sa croissance, étaient médiocres. L’appareil industriel était alors menacé. A tel point qu’on a calculé des « indicateurs de menace » très élevés au Brésil. Aujourd’hui, ce pays, en terme d’appareil industriel, est plus fragile qu’il y a dix ou quinze ans malgré tous les efforts qui ont été faits et qui sont indéniables sur le plan social notamment. Ce pays de plus de 200 millions d’habitants a d’énormes besoins. Il suffit de regarder le taux de croissance démographique. S’il est faible aujourd’hui, ce n’était pas le cas il y a quinze ans. Ces jeunes de quinze ans entrent sur le marché du travail aujourd’hui et le Brésil aurait besoin de réformes structurelles importantes pour créer des emplois.
GB : Mais tous les pays dits « émergents » ne rencontrent-ils pas le même type de difficultés ?
PS : Tous les pays « émergents » sont affectés par la crise, sauf peut-être la Corée du Sud et encore, mais les difficultés rencontrées par la Chine sont à distinguer de celles de l’Amérique latine. La croissance de la Chine est passée de 10 à 7,3 %. Cela reste un chiffre important, mais, comme en Amérique latine, la décélération s’est précipitée. Les difficultés de la Chine sont d’un ordre différent parce que son taux d’investissement est d’environ 50% du PIB, ce qui est phénoménal. Mais ces efforts d’investissements ont été financés par la spoliation des paysans, l’exploitation des « Mingong » (les travailleurs sans droits), les épargnants et la spéculation immobilière, ce qui a fragilisé le système. Selon certains économistes, la possibilité d’un hard landing (atterrissage en catastrophe) n’est pas à exclure. Ce qui serait une catastrophe pour tout le monde.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que depuis la crise dans les « pays avancés », la Chine a changé son fusil d’épaule. Elle joue moins la croissance débridée via les investissements massifs et les exportations que le marché intérieur. Cet objectif exige une diminution des inégalités et la reconnaissance des droits civiques et sociaux des 260 millions de « Mingong » comme la possibilité pour ces derniers de bénéficier de la sécurité sociale (retraite, santé) et d’envoyer leurs enfants dans des écoles publiques plutôt que de leur payer des écoles privées lorsqu’ils le peuvent. Cela signifie imposer davantage les classes moyennes des villes qui ont profité de ce système. Or tout le système chinois s’est bâti sur l’accroissement des inégalités. La Chine a de plus en plus de mal à maintenir « sa » paix sociale, il y a une multitude de grèves ouvrières en ce moment et son système de contrôle, de maîtrise des conflits sociaux est de plus en plus inefficace.
GB : L’hétérogénéité des processus de transformations économiques décrite dans votre livre révèle l’existence de deux profils parmi les « pays émergents ». La césure est-elle si nette que l’on puisse parler de « cigales » et de « fourmis », comme vous le faisiez à propos du bloc latino-américain dans votre précédent ouvrage ?
PS : Il y a deux manières de comprendre le terme de « cigales » et de « fourmis ». La première consistait à dire que les « fourmis » sont les pays asiatiques et les « cigales », les pays latino-américains. Mais tel n’était pas mon propos. A mes yeux, depuis 2003 et jusqu’en 2010-2011, on s’est aperçu que le taux de croissance moyen était d’un point supérieur à celui des années 1990. Manifestement quelque chose s’est passé, l’Amérique latine n’était alors plus « cigale » et pas tout à fait « fourmi » non plus. Ceci dit, il semble qu’on arrive à la fin d’un processus et que ces pays, Chine comprise, sont à un carrefour où il faut changer de direction, c’est-à-dire de régime de croissance. La croissance devient soit très faible, soit ralentie avec des risques de crise importants. C’est pourquoi j’ai remplacé les termes de « fourmis » ou de « cigales » par le point d’interrogation dans mon dernier livre (Des pays émergents ?). Bien qu’ayant montré les limites du mal développement latino-américain, peut-être ai-je été un peu trop optimiste en pensant que ces pays pouvaient devenir des « fourmis ». Aujourd’hui, je crois que la crise existante dans les pays asiatiques a fini par raviver toutes les contradictions qu’avaient dépassées, peut-être trop superficiellement, les pays latino-américains.
GB : Vous consacrez un chapitre à la définition des classes moyennes. Pourquoi n’est-il pas toujours pertinent, selon vous, de considérer que c’est l’essor des classes moyennes qui favorise la croissance ? De ce point de vue, quelles sont les différences entre la Chine et le Brésil par exemple ?
PS : Sans même parler des politologues et des sociologues, les économistes définissent de façon beaucoup trop caricaturale les classes moyennes. Pour eux, elles se situent entre tel et tel niveau de revenu. Pour les responsables politiques, il suffit de prendre une tranche inférieure suffisamment basse et une tranche supérieure assez haute pour considérer par exemple qu’au Brésil, 57 % de la population fait partie de la classe moyenne. C’est un facteur de légitimation politique tendant à faire croire qu’on a résolu le problème de la pauvreté. Le seul problème, c’est que si on chasse la réalité par la porte, elle revient par la fenêtre comme l’ont prouvées les manifestations au Brésil en 2013. Les manifestants disaient que s’ils faisaient partie des classes moyennes, ils ne bénéficiaient ni des infrastructures, ni des prestations de santé et d’éducation correspondant à ces classes. Le Brésil n’est pas un pays de classes moyennes. Dans le meilleur des cas, c’est plutôt 30 % de la population qui fait partie des classes moyennes, ce qui est beaucoup, mais cela signifie aussi que si ces classes moyennes vivent comme celles des « pays avancés », alors les autres, les plus pauvres, ont des revenus extrêmement bas et que le niveau d’inégalité est très élevé. Si ce niveau d’inégalité n’était pas très élevé au Brésil, il n’y aurait même pas 10 % de classes moyennes.
GB : Vous considérez même que l’essor des classes moyennes peut desservir la croissance et constituer un frein pour les pays dits « émergents ».
PS : Les autorités brésiliennes ont considéré qu’il fallait aider les classes moyennes pour favoriser la croissance. Pour avoir travaillé sur la question, les choses sont plus complexes que cela. Dans les années 1970, pendant la dictature militaire, il y a eu une élévation des classes moyennes, ce qui a augmenté la demande en « biens de luxe », comme les automobiles. Avec 8% de croissance en moyenne par an, la pauvreté a diminué mais les inégalités ont augmenté. En réalité, on a réduit le salaire des ouvriers de 49% en laissant courir l’inflation, ce qui a permis d’investir dans des secteurs à faible marge comme l’automobile, ce qui a généré des emplois de techniciens par exemple pour les classes moyennes. A l’origine de ce « miracle économique », il y a donc une pression très sévère sur les ouvriers rendue possible par le coup d’Etat militaire et la dictature qui s’en est suivie. C’est pourquoi je suis extrêmement perplexe sur le fait que les classes moyennes favorisent la croissance... alors qu’une redistribution des revenus peut stimuler la demande et la croissance à la condition toutefois qu’une politique industrielle agressive et audacieuse soit mise en place pour rendre compétitifs certains pans de l’industrie qui ne le sont plus.
Pour la Chine, le problème est différent. Si on considère que 20 à 30% de la population fait partie des classes moyennes, en terme relatif, c’est énorme car sa population est de 1,4 milliards de personnes... ce qui fait vendre beaucoup de voitures. Cependant, cette dynamisation de la croissance par les classes moyennes ne se met en place que grâce à l’exploitation des travailleurs dont le salaire a augmenté beaucoup plus lentement que le leur. Résultat : baisse de la pauvreté et augmentation des inégalités. La croissance ne se manifeste que jusqu’à ce que les inégalités deviennent insupportables, ce qui est le cas aujourd’hui.
Voilà pourquoi il faudrait qu’en Amérique latine il y ait une vraie réforme fiscale qui organise une amputation du salaire des riches, mais aussi des classes moyennes. Un seul exemple, un professeur du supérieur touche un peu plus que son homologue en France, sauf que le revenu brésilien moyen représente entre un quart et un tiers de celui de la France...
Cette réforme fiscale n’est pas évidente à réaliser car il y a de nombreux intérêts contradictoires en jeu. Pourtant elle est nécessaire et devra, pour être effective et aller au-delà des mots, être portée par des mobilisations de masses...
Propos recueillis pour Mémoire des luttes par Guillaume Beaulande.
Edition : Mémoire des luttes
 Lecture .
Lecture .