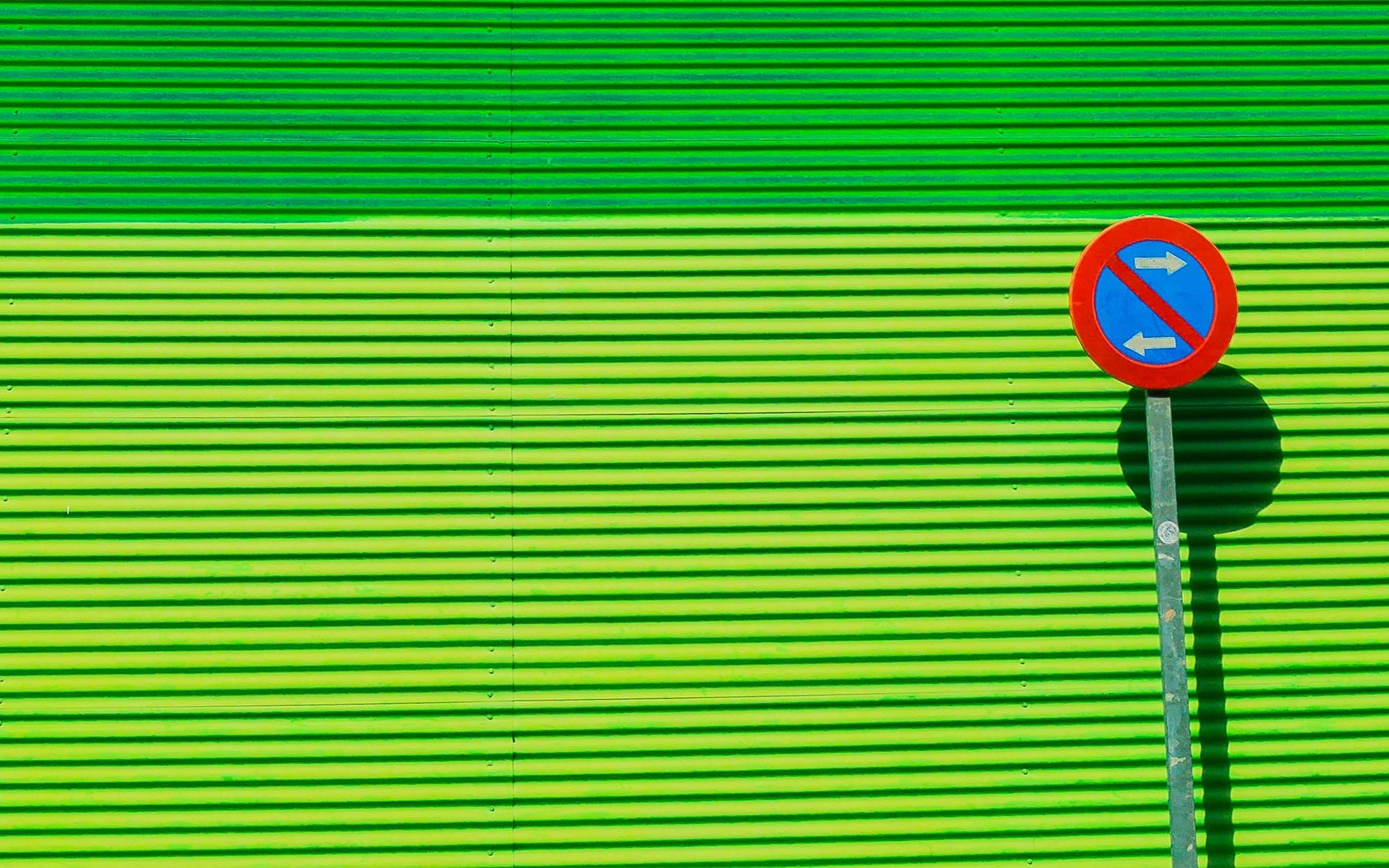La social-démocratie a connu son apogée entre 1945 et la fin des années 1960. A l’époque, elle représentait une idéologie et un mouvement qui revendiquaient l’utilisation des moyens de l’Etat pour garantir un certain niveau de redistribution à la majorité de la population sur des aspects concrets de la vie : développement des services de santé et d’éducation ; niveaux de revenu garantis tout au long de la vie grâce à des programmes de soutien aux besoins des groupes non-« salariés », en particulier les enfants et les retraités ; programmes visant à réduire le chômage. La social-démocratie promettait un avenir toujours meilleur aux générations futures, un niveau toujours croissant des revenus de la nation et des familles. C’était l’État providence, le « welfare state ». C’était une idéologie qui reflétait l’idée que le capitalisme pouvait être « réformé » et prendre un visage plus humain.
Les sociaux-démocrates étaient particulièrement puissants en Europe occidentale, en Grande-Bretagne, en Australie et Nouvelle-Zélande, au Canada et aux Etats-Unis (avec les démocrates du New Deal). En bref, dans les pays riches du système-monde, ceux qui formaient ce qu’on pouvait appeler le monde paneuropéen. Leur réussite fut telle que leurs opposants de centre-droit firent également leurs le concept d’Etat providence, simplement en s’efforçant d’en réduire les coûts et l’étendue. Dans le reste du monde, les Etats cherchèrent à prendre le train en marche en lançant des projets de « développement » national.
La social-démocratie fut une réussite éclatante pendant ces années. Elle était aidée par deux réalités de l’époque : l’expansion extraordinaire de l’économie-monde qui ce faisant créa les ressources rendant la redistribution possible ; et l’hégémonie des Etats-Unis dans le système-monde qui assura la relative stabilité de ce dernier, en particulier grâce à l’absence de conflits sérieux au sein de cette zone prospère.
Ce tableau idyllique et ces deux réalités ne durèrent qu’un temps : l’économie-monde arrêta son expansion et entra dans une longue période de stagnation qui n’est toujours pas terminée ; quant aux Etats-Unis, ils commencèrent leur long, quoique lent, déclin en tant que puissance hégémonique. Ces deux nouvelles réalités se sont considérablement accélérées au XXIème siècle.
Cette nouvelle ère, qui connut son essor dans les années 1970, assista à la fin du consensus centriste mondial sur les vertus de l’Etat providence et du « développement » dirigé par l’Etat. Une nouvelle idéologie, plus à droite, appelée néo-libéralisme ou Consensus de Washington, prit sa place. Elle prêchait la confiance dans les mérites du marché plutôt que dans ceux de l’Etat. Ce programme était, dit-on, fondé sur la soi-disant nouvelle réalité de la « mondialisation » à laquelle « il n’y avait pas d’alternative ».
La mise en œuvre des programmes néolibéraux sembla permettre de maintenir à flots la « croissance » des cours boursiers. Mais dans le même temps, elle déboucha, dans le monde entier, sur un endettement et un chômage grandissants et sur des revenus réels plus faibles pour la grande majorité de la population mondiale. Les partis qui avaient été les piliers des programmes sociaux-démocrates de centre-gauche n’en dérivèrent pas moins de plus en plus à droite : en évitant de soutenir ou d’afficher leur soutien à l’Etat providence, en acceptant que le rôle des gouvernements réformistes fût considérablement réduit.
Mais alors que les conséquences négatives pour la majorité des peuples se faisaient sentir y compris dans le monde riche paneuropéen lui-même, elles étaient encore plus durement ressenties dans le reste du monde. Comment les gouvernements du Sud allaient-ils réagir ? Ils commencèrent à profiter du déclin économique et géopolitique relatif des Etats-Unis (et plus largement du monde paneuropéen) en se concentrant sur leur propre « développement » national. Ils utilisèrent la puissance de leur appareil étatique et de leurs coûts de production globalement plus faibles pour devenir des nations « émergentes ». Plus la rhétorique, et même les engagements politiques, étaient marqués « à gauche », plus ils étaient déterminés à se « développer ».
Cela marchera-t-il pour eux comme cela avait jadis marché pour le monde paneuropéen dans la période poste-1945 ? Ceci est loin d’être évident, et ce malgré les remarquables taux de « croissance » de certains de ces pays, en particulier chez les « BRIC » (Brésil, Russie, Inde, Chine), au cours des cinq ou dix dernières années. C’est qu’il existe quelques sérieuses différences entre l’état actuel du système-monde et sa situation juste après 1945.
Premièrement, les coûts réels de production, en dépit des efforts des néolibéraux pour les réduire, sont aujourd’hui en réalité considérablement plus élevés qu’ils ne l’étaient dans la période post-1945. Ils menacent de ce fait les possibilités réelles d’accumulation de capital. Cela rend le capitalisme en tant que système beaucoup moins intéressant pour les capitalistes. Les plus perspicaces d’entre eux sont en quête d’autres alternatives pour préserver leurs privilèges.
Deuxièmement, la capacité des pays émergents à augmenter à court terme leur accumulation de richesses a placé sous fortes tensions les ressources disponibles à même de satisfaire leurs besoins. Il y a une compétition de plus en plus aiguisée pour l’acquisition de terres, pour les ressources en eau, alimentaires, énergétiques. Cela aboutit non seulement à des luttes féroces mais cela débouche aussi sur une réduction de la capacité mondiale des capitalistes à accumuler du capital.
Troisièmement, l’énorme développement de la production capitaliste a fini par mettre la planète sous une pression écologique telle que le monde est entré dans une crise climatique dont les conséquences menacent la qualité de la vie partout dans le monde. Cette expansion capitaliste a aussi encouragé le développement d’un mouvement qui remet en cause radicalement les vertus de la « croissance » et du « développement » en tant qu’objectifs économiques. Cette demande croissante d’une autre perspective « civilisationnelle » est ce qu’on appelle en Amérique latine le mouvement du « buen vivir », le « bien vivre ».
Quatrièmement, les revendications des groupes subordonnés pour obtenir un vrai degré de participation dans les processus de décision de la planète ont fini par viser non seulement les « capitalistes » mais aussi les gouvernements de « gauche » qui promeuvent le « développement » national.
Cinquièmement, la combinaison de tous ces facteurs, ainsi que le déclin visible de la puissance jadis hégémonique, a créé un climat de fluctuations constantes et radicales tant dans l’économie-monde qu’en matière géopolitique, avec pour résultat de paralyser à la fois les entrepreneurs du monde entier et les gouvernements du monde entier. Le degré d’incertitude, non seulement de long terme mais aussi de très court terme, s’est nettement accru et avec lui le niveau réel de violence.
La solution social-démocrate est devenue une illusion. La question est de savoir ce qui la remplacera pour la grande majorité des peuples de la planète.
© Immanuel Wallerstein, distribué par Agence Global. Pour tous droits et autorisations, y compris de traduction et de mise en ligne sur des sites non commerciaux, contacter : rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 ou 1.336.286.6606. Le téléchargement ou l’envoi électronique ou par courriel à des tiers sont autorisés pourvu que le texte reste intact et que la note relative au copyright soit conservée. Pour contacter l’auteur, écrire à : immanuel.wallerstein@yale.edu.
Ces commentaires, bimensuels, sont des réflexions consacrées à l’analyse de la scène mondiale contemporaine vue dans une perspective de long terme et non de court terme.
 Lecture .
Lecture .