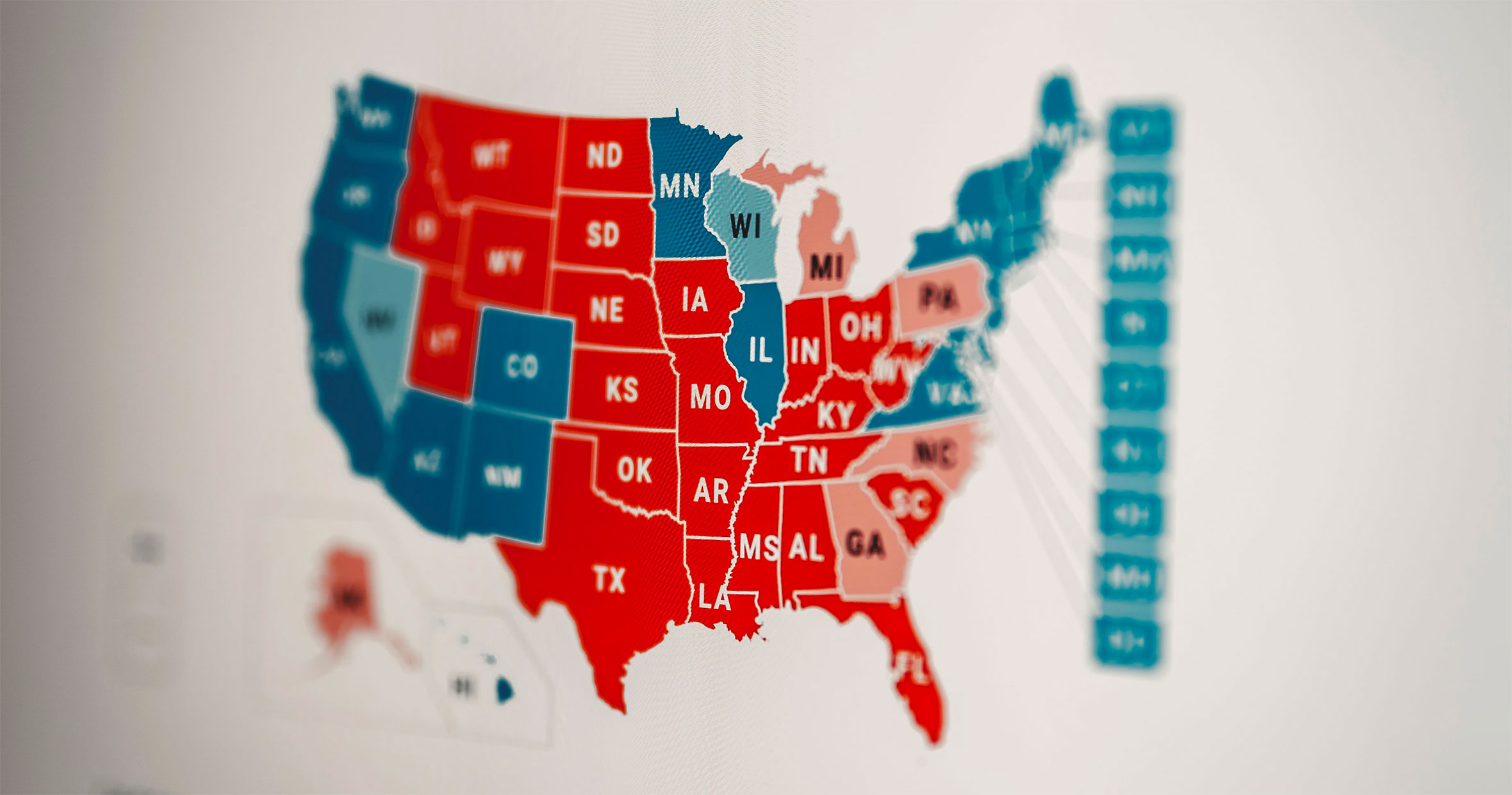Dès le 23 octobre, reçu dans le « Tonight Show » de Jimmy Fallon, sur la chaîne NBC, le sénateur Bernie Sanders, éliminé de la course à la Maison-Blanche car trop « à gauche » pour ses « amis » démocrates, avait prévu la situation. Pandémie de Covid-19 oblige, estimait-il, le vote par correspondance – les « absentee ballots » – allait considérablement augmenter et, en bonne logique, les électeurs démocrates, plus respectueux de la distanciation sociale, favoriseraient ce mode de vote par anticipation. « Pour des raisons que je n’ai pas le temps d’expliquer ce soir, déclara Sanders, vous allez avoir une situation, je suppose, dans des Etats comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et d’autres, où vous allez recevoir d’énormes quantités de bulletins de vote par la poste. Contrairement à des Etats comme la Floride ou le Vermont, ils ne peuvent pas, pour de mauvaises raisons, commencer à traiter ces bulletins avant, je ne sais pas, le jour des élections ou peut-être la fermeture des bureaux de vote. Cela signifie que les Etats vont devoir traiter des millions de bulletins de vote par correspondance. » Dans ces conditions, le républicain Donald Trump pourrait très bien se retrouver en tête des décomptes dans certains Etats, le soir du scrutin, et devancé le ou les jours suivants par son adversaire démocrate Joe Biden, une fois tous les bulletins dépouillés. D’où cette prédiction de Sanders : « A ce moment-là, Trump dira : "Vous voyez ? Je vous avais dit que tout cela était une escroquerie. Je vous avais dit que ces bulletins étaient truqués. Nous ne quitterons pas nos fonctions." C’est une préoccupation que beaucoup de gens et moi-même avons... Les gens doivent être conscients de cette possibilité. »
Sans lui retirer aucun des mérites que lui reconnaissent ses partisans, on ne qualifiera pas Sanders de « prophète ». Le 30 juillet, invoquant les « risques de fraudes » liés à la mise en place du vote par correspondance, Trump en personne avait annoncé la couleur et évoqué « l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l’Histoire ». Ce en quoi il n’innovait guère. En 2016 déjà, à la fin du troisième débat l’opposant à Hillary Clinton, il avait provoqué la stupeur en refusant de s’engager à accepter les résultats du scrutin : « Je verrai en temps voulu », avait- il déclaré.
On ne peut donc mettre les derniers événements sur le compte d’une quelconque improvisation. Le 4 novembre, lors de sa première prise de parole après la fermeture des bureaux de vote, et sans s’embarrasser des quelques millions de bulletins restant encore à dépouiller [1], le président sortant s’est autoproclamé vainqueur en dénonçant que certains Etats aient arrêté de compter les bulletins le temps de la nuit : « C’est une fraude contre le peuple américain. C’est une honte pour notre pays. Nous étions en train de gagner cette élection. Franchement, nous avons gagné cette élection. » Quelques heures plus tard, il dénoncera la dynamique désormais favorable à Biden : « Hier soir, j’avais une bonne avance dans de nombreux Etats décisifs, puis, un par un, ils ont commencé à disparaître par magie avec l’apparition et le comptage de bulletins surprises. Très étrange. »
De là à réclamer la suspension du dépouillement des votes par correspondance, en particulier dans le Michigan, la Géorgie et en Pennsylvanie, il n’y avait qu’un pas, allégrement franchi. Dans une réaction officielle, la directrice de campagne de Biden, Jen O’Malley Dillon, a déclaré scandaleuses, sans précédent et incorrectes les déclarations du président : « Scandaleuses parce qu’il s’agit d’un effort évident pour retirer les droits démocratiques aux citoyens américains. Sans précédent, car jamais auparavant dans notre histoire un président américain n’avait tenté de priver les Américains de leur voix lors d’une élection nationale. » Même la chaîne CNN, à travers ses commentateurs, a jugé la réaction de Trump « contraire à la démocratie ».
Dont acte, aux uns et aux autres. Mais on leur fera remarquer – et pas uniquement à eux ! – qu’ils auraient pu se montrer aussi clairvoyants en octobre 2019 lorsque se produisit le même phénomène en… Bolivie. Le dimanche 20 octobre, le décompte de 84 % des voix donnait au président sortant Evo Morales, candidat à la réélection en représentation du Mouvement pour le socialisme (MAS), une avance de sept points sur son concurrent de droite Carlos Mesa (45,28 % des voix contre 38,16 %), plaçant ce dernier en position de disputer un second tour. Après une interruption nocturne du dépouillement, le décompte du lundi soir changea la donne. Morales devançait à présent Mesa de dix points et, avec 46,8 % des suffrages contre 36,7 %, l’emportait dès le premier tour [2].
Aussi « trumpistes » que Trump, leur grand allié, la droite et l’extrême droite boliviennes, ainsi que quelques renégats censément « de gauche », hurlèrent à la fraude. Chargée d’observer le processus électoral, l’Organisation des Etats américains (OEA), aux ordres et à la botte de Washington, leur vint en aide en dénonçant un « changement inexplicable de tendance ».En fait, comme on l’avait constaté lors des élections précédentes, les zones rurales, indiennes et paysannes, très majoritairement favorables à « Evo », mais dont les résultats arrivaient en dernier du fait des difficultés de communication, avaient fait basculer définitivement le résultat [3].
La suite est connue. Washington parla d’une tentative de « subversion de la démocratie ». Encouragés, les « ultras » boliviens déclenchèrent une vague de violence qui déboucha sur un coup d’Etat. Que l’Union européenne entérina. Le mimétisme moutonnier faisant le reste, l’immense majorité de la « communauté médiatique » ratifia la thèse de « la fraude », responsable de la crise qui s’ensuivit. Aux Etats-Unis mêmes, seul Bernie Sanders qualifia de putsch l’éviction de Morales. Egalement classée « à gauche » du Parti démocrate, la sénatrice du Massachusetts, Elisabeth Warren, évita soigneusement d’utiliser l’expression « coup d’Etat » et qualifia le « gouvernement » de la présidente autoproclamée Jeanine Añez de « leadership intérimaire », validant ainsi la nouvelle administration [4]. Il est vrai que, comme Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Warren a reconnu en Juan Guaidó le président du Venezuela, que seul Trump et son équipe ont élu à cette haute fonction ; elle a également approuvé l’utilisation des sanctions aussi illégales que criminelles imposées à ce pays.
S’agissant de la Bolivie, et laissant la voie libre aux faucons républicains, l’ensemble du Parti démocrate s’est donc très ostensiblement désintéressé de la question.
Pour Washington et les « élites politiques » conservatrices qui, dans les Amériques, lui servent de relais en même temps qu’elles défendent leurs propres intérêts, les élections sont certes indispensables, mais à une condition : il faut pouvoir garantir que les gens votent comme il faut. De sorte que, chanté depuis la droite du noble orchestre de la Démocratie, et promus par le puissant voisin du Nord, le « grand air de la fraude » est depuis longtemps un grand classique dans la région.
En 2008, au Nicaragua, lors d’élections municipales largement remportées par le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) – 109 villes sur 153 –, le candidat battu pour la mairie de Managua, le banquier Eduardo Montealegre, hurle au scandale et exige un recomptage des votes. Lorsque le Conseil suprême électoral (CSE) accepte la requête, il refuse d’assister à l’opération. Il n’apportera ultérieurement aucune des « preuves » censées sustenter son accusation.
Le 6 novembre 2011 voit la réélection du sandiniste Daniel Ortega, avec 62 % des suffrages. Arrivé en deuxième position avec 31 % des voix, le représentant du Parti libéral indépendant (PLI), Fabio Gadea, conteste sa défaite, prétendant avoir lui-même recueilli 62 % des voix (alors que tous les sondages lui avaient accordé environ 30 %). Alertant la « communauté internationale » (comprendre : les Etats-Unis et l’Union européenne) acquise à sa cause, il annonce une protestation massive et, pour le 3 décembre suivant, cent mille manifestants dans les rues de la capitale Managua. Présent sur place, nous n’assistons qu’à un défilé de cinq à dix mille personnes (en l’absence d’un appareil massif de répression).
Lorsque Ortega est réélu pour un troisième mandat le 6 novembre 2016, le CSE annonce une abstention de 31,8 % ; sans citer aucune source identifiable, la coalition d’opposition du Front large de la démocratie (FAD) l’estime à plus de 70 % et, comme d’habitude, conteste le résultat du scrutin.
A chaque fois, invoquant « la fraude », l’administration américaine (en l’occurrence celles de George W. Bush et Barack Obama) condamne (et sanctionne) l’indésirable vainqueur. A chaque fois, la sphère médiatique, sans plus d’hésitations que de preuves, enferme le Nicaragua dans la catégorie des « Etats voyous » [5].
Novembre 2009, en Haïti : trois jours d’émeute pour contester un résultat ! Le Conseil électoral provisoire (CEP) a bien exclu quatorze partis politiques – dont Fanmi Lavalas, formation de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide (deux fois bouté hors du pouvoir par des coups d’Etat) –, ce n’est pas suffisant. Les Haïtiens ont mal voté. Le premier tour de l’élection présidentielle a placé Mirlande Manigat (31,4 %) et Jude Célestin (22,5 %) devant le candidat de Washington Michel Martelly (21,8 %), dès lors éliminé pour le deuxième tour. Jeté dans la rue par ce dernier, un dévergondage de gens de toutes sortes sème le chaos. Sensibles à cette mobilisation de la « société civile » et sur la base d’un rapport fort bien venu de l’OEA, les principaux bailleurs de fonds, Washington en tête, obligent le CEP à modifier les résultats. Celui-ci installe Martelly en deuxième place, permettant ainsi à cet individu carrément corrompu, franchement incompétent, de participer au second tour et de devenir président de la République le 20 mars 2011.
L’année suivante, au Venezuela, le camp bolivarien emmené par Hugo Chávez continuant manifestement à envisager sa permanence au pouvoir, l’oppositionsonne le tocsin. Pourtant, le 15 septembre, l’argentin Carlos Álvarez, chef de la Mission d’observation électorale de l’Union des Nations sud-américaines (Unasur), a déclaré : « Il est intéressant de souligner un élément que très peu connaissent, je parle surtout de ceux qui analysent la réalité depuis la désinformation ou les préjugés, c’est que le Venezuela possède aujourd’hui l’un des systèmes électoraux les plus vigoureux et les plus avancés technologiquement de l’Amérique latine, ce qui garantit la transparence, le contrôle et la surveillance du scrutin. » La semaine précédente, l’ancien président américain James Carter, dirigeant du Centre éponyme, avait pour sa part déclaré : « En réalité, sur les quatre-vingt-douze élections dont nous avons surveillé le déroulement, je dirais que le processus électoral du Venezuela est le meilleur du monde »…
Il n’en demeure pas moins que, à l’instar de Rafael Poleo, directeur du quotidien El Nuevo País, qui a écrit le 7 août « ignorer que le gouvernement prépare une fraude est une idiotie », l’opposition ne cesse de mettre en cause l’impartialité du Conseil national électoral (CNE) ; chaque fois qu’on le lui demande, Henrique Capriles, le candidat de droite, se refuse à préciser si, dans l’hypothèse où il lui serait défavorable, il acceptera le résultat (Trump n’a rien inventé).
Manque de chance : le 7 octobre, jour du scrutin, un million six cent mille voix de différence constituent une marge suffisante pour couper court à toute contestation. Avec 55,1% des votes et quasiment dix points d’avance, le président en exercice repart pour un nouveau de mandat. Capriles range provisoirement ses protestations dans son chapeau.
Chávez disparu, les Vénézuéliens élisent son dauphin Nicolás Maduro, le 14 avril 2013, avec 50,60 % des voix (n’importe quel fraudeur moyennement intelligent aurait porté cet avantage à 55-60 % pour éviter ce résultat « ric-rac » ; un vrai dictateur aurait, lui, gagné avec au minimum 80 %). Qu’importe. Capriles refuse d’admettre sa défaite. Le fait devrait surprendre : tout comme il a accepté avoir perdu lors de la présidentielle précédente, organisée par le même CNE, il n’a pas mis en cause l’arbitre électoral lorsque, quelques semaines auparavant, il a été réélu gouverneur de l’Etat de Miranda avec moins de trente mille voix d’avance sur le candidat du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) Elías Jaua. Appuyé par le secrétaire d’Etat américain John Kerry, l’OEA et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, Capriles demande un recomptage de « tous » les bulletins de vote. Puis déclenche l’escalade en appelant ses partisans à exprimer leur « arrechera » – mélange de rage et de hargne mêlées d’indignation morale – dans les rues. Suggérée sur les réseaux sociaux par le journaliste d’opposition Nelson Bocaranda, au prétexte que « les médecins cubains cachent des urnes pleines de bulletins de vote », des centres médicaux sont attaqués, incendiés et détruits. La vague de violence provoque la mort de onze personnes. Comme elles sont toutes chavistes, les grandes multinationales dites de défense des droits de l’Homme ne s’emparent pas de la question.
Contrairement à ce que croient certains niaiseux, l’impérialisme ne se manifeste pas que sous la forme extrême de l’intervention militaire et de l’invasion armée. Aux coups d’Etat menés à bien par des acteurs locaux, tentatives de déstabilisation, mesures coercitives unilatérales, guerres non conventionnelles, opérations clandestines, s’ajoutent les techniques de désinformation permettant de diaboliser l’ « ennemi ». Quoi de plus efficace, pour transformer un pays en « dictature », face à l’opinion internationale, que d’y remettre en cause l’honnêteté des processus électoraux ?
Au Venezuela, la comédie dure depuis deux décennies. Quand, en 2004, Chávez gagna un référendum révocatoire avec 59 % des suffrages exprimés, le dirigeant d’opposition Henry Ramos Allup dénonça une « gigantesque fraude » dont il présenterait les preuves dans les vingt-quatre heures. Seize années plus tard, on ne les a pas encore vues. Mais d’aucuns prennent toujours Ramos Allup au sérieux.
En 2018, en pleine période de déstabilisation économique, les leaders de l’opposition, sur ordre explicite de Washington, refusent de participer à la présidentielle et appellent à la boycotter. D’autres dirigeants, tout aussi critiques à l’égard du « chavisme », mais plus soucieux de l’intérêt général, se portent malgré tout candidats. Dans un tel contexte, 9,2 millions de citoyens se rendent aux urnes (46,02 % de participation). Maduro l’emporte avec 68 % des voix, devant Henri Falcón (ex-chef de campagne d’Henrique Capriles ; 21 %) et le pasteur Javier Bertucci (11 %). Ce qui se passe à ce moment ne peut même plus être placé dans la catégorie « comique de répétition » : soumis à une pression extrême des « ultras » étatsuniens et vénézuéliens, Falcón refuse soudain de reconnaître la légitimité du scrutin et exige… d’en organiser un autre. « On pourrait les faire en octobre et nous, nous sommes disposés une fois de plus, cohérents comme nous sommes [authentique !], à y participer. » Avec l’infime étincelle de lucidité qui semble lui rester, il constate néanmoins : « Aujourd’hui il est clair que cet appel à l’abstention a fait perdre une occasion extraordinaire de mettre un terme à la tragédie que vit le Venezuela. » Arrivé en troisième position, Bertucci n’entre pas dans une fausse polémique : « Les gens qui ont voté ont voté, on ne peut pas dire que le résultat n’est pas le produit du vote. »
En état de choc, échaudés, écœurés par l’irresponsabilité et l’incohérence de leurs dirigeants, les électeurs qui s’en réclament et les abstentionnistes ne descendent même pas dans la rue pour manifester. Nul n’y prête attention. L’effet troupeau faisant son œuvre, les médias dominants bourdonnent sur le même thème : la légende noire d’un Maduro « président illégitime » vient de naître.
On n’occultera pas ici que, le 30 juillet 2017, l’élection d’une Assemblée nationale constituante (ANC) avait été très controversée. Pas tant du fait du boycott des mêmes que l’année suivante et des violences qu’ils incitèrent alors à déclencher pour saboter la consultation. On déplora au moins quinze morts au cours de ce week-end, dont un sergent de la Garde nationale et un candidat chaviste. Vingt-et-un fonctionnaires de police furent blessés par arme à feu, huit gardes nationaux brûlés par un engin explosif. En vain : 8 089 320 Vénézuéliens se rendirent aux urnes pour élire leurs Constituants, soit 41,5 % de l’électorat.
Ces chiffres, bien sûr, furent immédiatement contestés. Toujours en première ligne dès qu’il s’agit de ruses, de manèges et de finasseries, Ramos Allup estima la participation à 12 %, soit à peine 2,4 millions de personnes. Plus troublante, et semant légitimement le doute, se révéla la déclaration d’Antonio Mugica, président de la firme Smartmatic, qui fournissait le software des machines à voter et l’assistance technique, quand il dénonça une manipulation des résultats. « Nous estimons que la différence entre la participation réelle et celle annoncé par les autorités est d’au moins un million de voix », déclare-t-il, depuis… Londres, trois jours après le scrutin.
Depuis, Mugica a disparu des radars, sans jamais avoir soumis à quiconque un quelconque rapport technique détaillé expliquant la supposée fraude, qui l’a réalisée et comment elle a été détectée. En revanche, tout observateur attentif dispose de quelques certitudes. Smartmatic, leader mondial en solutions électorales et de gestion d’identités, jouit d’une solide réputation internationale. Elle opère dans une quarantaine de pays. Sans jamais aucun incident, et défendant l’intégrité des résultats de douze élections vénézuéliennes successives, Smartmatic en encadrait techniquement le déroulement depuis 2004 – le vote étant complètement automatisé. Or, dans un contexte d’agression permanente, Washington venait d’annoncer des sanctions contre la présidente du CNE Tibisay Lucena, pour son rôle dans l’organisation de cette élection « illégale ». Toute entreprise travaillant avec le CNE risquait désormais d’être condamnées à de très fortes amendes par la justice étatsunienne et même de se voir exclue définitivement du marché américain. Or…
Après cette spectaculaire mise en cause de Caracas, et la rupture qui s’ensuivit, Smartmatic annoncera que l’Argentine (du président de droite Mauricio Macri) fait appel à sa technologie biométrique pour l’authentification de ses électeurs ; qu’elle présente sa technologie innovante aux experts et administrateurs électoraux du Royaume-Uni ; qu’elle participe à la mise en place de la même technologie innovante au Mexique (du président conservateur Enrique Peña Nieto) ; que, d’ici à 2020, « après une évaluation technique, légale et financière », le comté de Los Angeles achèvera avec elle l’installation d’un nouveau système de vote ; que la Commission européenne a attribué à son Centre d’excellence sur le vote par internet une nouvelle bourse de recherche dans le cadre du programme Horizon 2020 ; que, dans le secteur en charge des infrastructures électorales, elle intègre… le Conseil de coordination du Département de la sécurité intérieure des Etats-Unis ! Que des « amis » très chers du Venezuela ! Mieux vaut ne pas se placer sous l’épée de Damoclès des sanctions américaines quand on ne souhaite pas perdre de tels contrats [6].
« Personne n’a expliqué comment, pendant ces deux décennies de gouvernement bolivarien, l’opposition a presque toujours gagné, par exemple, dans l’Etat de Miranda, où se trouve la partie la plus grande et la plus puissante de Caracas, constate la philosophe et historienne vénézuélienne Carmen Bohórquez ; et qu’elle a également gagné à plusieurs reprises des Etats stratégiques tels que les Etats de Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta ou Amazonas [7]. » Néanmoins, au prétexte que « les conditions pour qu’il y ait des élections justes et démocratiques (n’y) sont pas réunies », l’Union européenne, en parfaite supplétive de l’administration Trump (et des ténors du Parti démocrate), refuse par avance de reconnaître les résultats des élections législatives organisées le 6 décembre prochain. Scrutin que, comme il se doit, leur petit protégé, l’autoproclamé Juan Guaido, appelle à boycotter. Une question, et non des moindres, demeurant néanmoins en suspens : le jour où aura lieu, au Venezuela, cette consultation électorale (à laquelle participent les factions non anti-démocratiques de l’opposition), connaîtra-t-on le nom du prochain président des Etats-Unis ?
Effarés, nombre d’Américains découvrent des méthodes que leurs gouvernements successifs ont sans vergogne appuyées, voire suscitées, à l’étranger. C’est que, à répandre cyniquement la peste chez les autres, on finit par l’attraper. Le 4 novembre, sans la moindre preuve, Trump s’est à nouveau posé en victime d’une vaste fraude électorale : « Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection ! » S’il perd (ce qui est probable, mais pas absolument certain, à l’heure de la rédaction de ce billet), il va multiplier les recours en justice et en appelle déjà à la Cour suprême, pour que « la loi soit respectée et utilisée de manière appropriée ». La partie est loin d’être terminée.
Mais au fait… Où est passée l’OEA ? Pas d’ironie facile : elle est là et bien là. Défenseur intraitable, scrupuleux et désintéressé de la pureté des processus démocratiques sur le continent, son secrétaire général Luis Almagro a dirigé en personne une mission d’observation électorale. Pour ces minuscules Etats-Unis, pays de 328 millions d’habitants répartis sur 9,834 millions de Km², 28 experts et observateurs ont été déployés ; rien à voir avec l’immense Bolivie (11,35 millions d’habitants, 1,098 million de Km²) qui avait nécessité… 92 experts et observateurs déployés en 2019 dans les neuf départements du pays et dans trois pays étrangers (Argentine, Brésil et Etats-Unis) pour y surveiller le vote des expatriés.
Disons qu’au sein de l’OEA, et en matière de surveillance du respect de la démocratie, tous les pays sont égaux, mais que certains sont plus égaux que d’autres. « En raison de la nature décentralisée de l’administration électorale aux Etats-Unis, explique le Rapport préliminaire rendu public le 6 novembre, la Mission a dû obtenir l’autorisation de chaque Etat afin d’observer leurs processus de vote. La Mission a donc contacté les autorités de quatorze Etats [sur cinquante !] et du district de Columbia pour demander un accès pendant la période préélectorale et le jour du scrutin. (…) En fin de compte, les restrictions résultant de COVID-19 ainsi que d’autres facteurs échappant au contrôle de la Mission ont limité les Etats dans lesquels elle a pu se déployer [8]. » Et pour cause : certains Etats n’autorisent pas ou ne prévoient pas de dispositions spécifiques pour l’observation internationale de leurs processus électoraux. Et n’ont pas l’intention d’y changer quoi que ce soit. De sorte que l’imposante « Mission de l’OEA pour les élections présidentielles américaines » n’a été en réalité présente qu’en Géorgie, dans l’Iowa, dans le Maryland, dans le Michigan et dans le district de Columbia [9] !
Dans le rapport préliminaire qui en découle, l’OEA indique qu’elle « n’a pas directement observé de graves irrégularités jetant le doute sur les résultats » Préalablement, elle a mentionné sur un ton critique qu’ « un candidat en particulier » a fait référence à la « progression et à la crédibilité du vote » ce qui a ensuite conduit sa campagne à « contester le processus en cours et les résultats devant les tribunaux ». « Un candidat en particulier »… Jamais le nom de Donald Trump n’est mentionné. Il a plus de chance qu’Evo Morales, nommément cité et épinglé à de multiples reprises dans les mensongers rapports préliminaire et définitif de 2019. Mais Almagro n’insulte pas l’avenir. Le 6 novembre, date de publication de ce premier document, il n’est pas encore certain que Trump ait perdu l’élection.
On se permettra tout de même d’interpeller le secrétaire général sur cette « mission d’observation électorale à portée limitée » (expression employée dans le rapport précité). Plutôt que vouloir imposer autoritairement ses diktats à la Bolivie, au Nicaragua, au Venezuela ou aux autres pays de la région, ne devrait-il pas, en priorité, exiger des Etats-Unis un accès sans limites à l’observation de ses élections ? (excusez, « it’s a joke » : on n’a jamais vu un « péon » [10] imposer quoi que ce soit à son patron). Autre question : dans la plus extravagante des hypothèses (mais qui sait…), le président français Emmanuel Macron recevra-t-il Trump à l’Elysée si celui-ci s’autoproclame chef de l’Etat ? Et encore : comme elle l’a fait avec la Bolivie post-coup d’Etat, pourquoi l’Union européenne ne se propose-t-elle pas comme médiatrice pour « pacifier le pays » ? Sans augurer du pire, on y note déjà une montée des tensions digne de la dernière des Républiques bananières. Selon le Washington Post, le Secret Service s’inquiète de la sécurité de Joe Biden : des agents ont été envoyés en renfort à Wilmington (Delaware) pour protéger son QG.
Illustration : Clay Banks / Unsplash